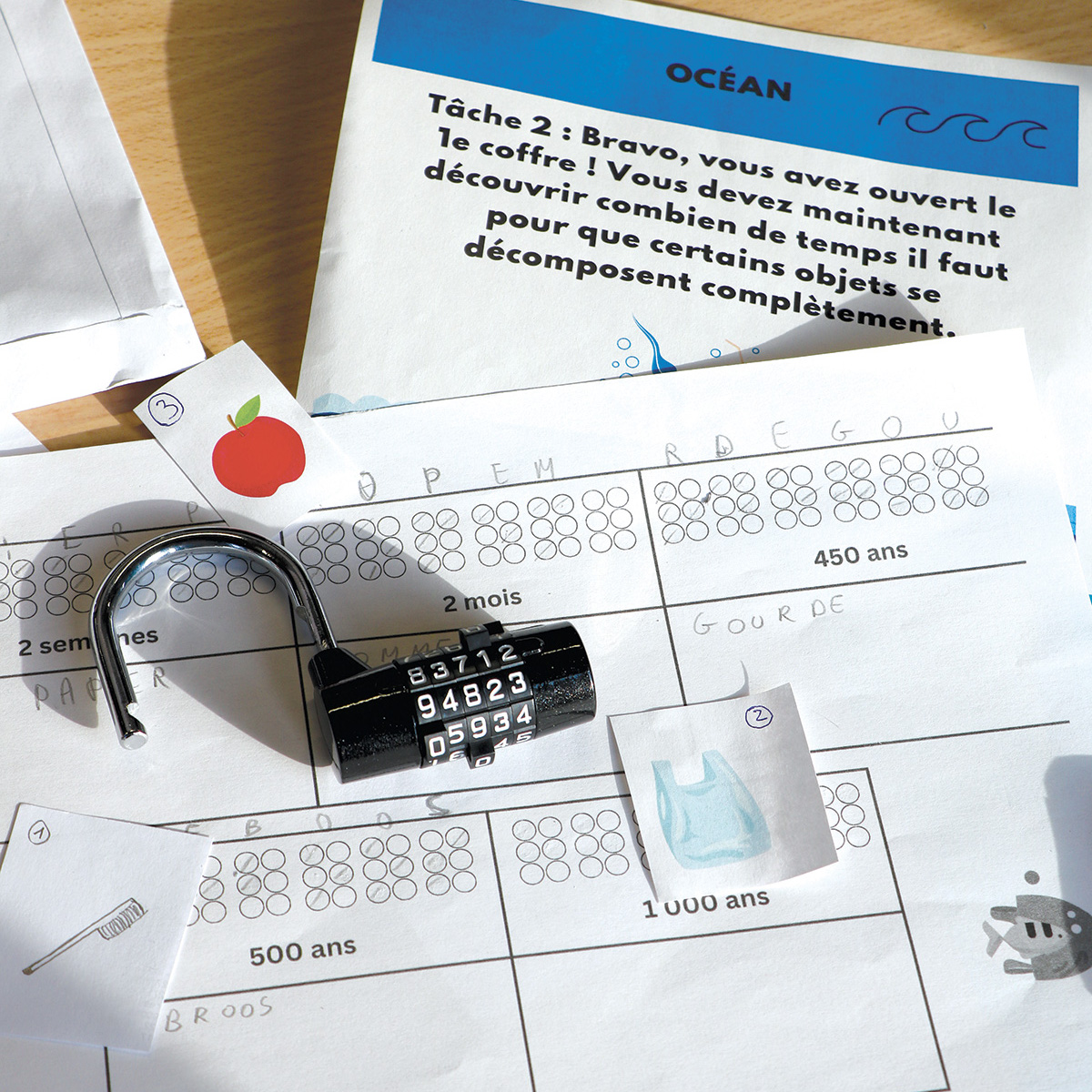Des jeux video pour changer de logiciel mental
Des jeux video pour changer de logiciel mental
Décembre 2023, par Christophe Dubois
Un article du magazine Symbioses n°139 : Faites vos jeux
Utilisés à des fins éducatives, les jeux peuvent apporter plaisir et motivation, développer les savoir-être, faciliter l’assimilation de connaissances... Mais ce n’est pas un jeu d’enfant. Tour d’horizon de leur potentiel éducatif et de quelques idées reçues.
Disons-le d’emblée, en éducation à l’environnement, les jeux vidéo n’ont pas bonne presse. Accusés d’isoler les jeunes, de les claquemurer, de les déconnecter du monde réel, de programmer l’obsolescence, d’épuiser les ressources (1), ils sont pour beaucoup d’animateurs et animatrices nature ce que Bowser est à Mario : l’ennemi juré.
Et pourtant, ces supports vidéoludiques ne sont pas dénués d’atouts pédagogiques. En témoigne Jonathan Ponsard, enseignant dans le primaire et responsable de l’eduLAB (2), où il forme les enseignant·es à l’intégration des nouvelles technologies. Depuis plusieurs années, il multiplie avec ses élèves les projets pédagogiques alliant le jeu vidéo et la sensibilisation à l’environnement. Son outil préféré ? Minecraft, le jeu vidéo de construction et d’aventure le plus joué de tous les temps. Ce bestseller ressemble à un jeu de Lego virtuel, dans lequel les joueurs et joueuses peuvent construire librement des mondes (bâtiments, grottes, personnages, arbres, lacs…) en ajoutant ou en détruisant des gros blocs, représentant différents matériaux.
Construction et apprentissages
Jonathan Ponsard nous emmène dans l’univers Minecraft créé avec sa classe verticale de 24 élèves (de la 1re à la 6e primaire), il y a quelques années : un écoquartier composé d’une grande habitation partagée, entourée de nature, équipée de panneaux solaires, d’un circuit de chauffage collectif, d’une station d’épuration en bloc d’éponges... A quelques pixels de là, une ferme imaginée par les enfants produit des céréales automatiquement. On peut même entrer dans une serre en aquaponie, identique à celle installée dans leur petite école rurale.
Ce projet s’est étalé sur plusieurs mois, à raison de deux périodes par semaine. Le temps de jeu – de 30 à 50’ par semaine – est systématiquement précédé d’une phase d’organisation et de recherche, et suivi d’un incontournable débriefing. « On a commencé par analyser des écoquartiers existants, raconte l’enseignant. Les enfants ont ensuite voté pour dix critères à respecter pour que le leur soit le plus écologique possible : autonome et économe en énergie et en ressources, bien situé pour limiter les déplacements, etc. » Une fois ces contraintes définies, vient seulement la construction proprement dite, par sous-groupes de 2 à 4 élèves. Techniquement, cela nécessite au minimum une dizaine d’ordinateurs ou de tablettes, un bon réseau, et de débourser 5 euros par an et par utilisateur pour la licence éducative du jeu (un compte Office 365 vous donne droit à 25 accès gratuits).
Chacun·e doit d’abord expliquer aux autres ce qu’il ou elle va faire. « Il y a une belle dynamique de coopération qui s’installe. Les enfants qui savent déjà jouer apprennent aux autres, explique ce fan de pédagogies actives. Moi, je suis juste là pour sélectionner quelques sources d’information fiables, faciliter et les guider vers l'objectif. » À la fin de chaque séance, collectivement, les élèves reviennent sur ce qui a fonctionné, les problèmes rencontrés, ce qu’ils et elles ont appris, les différences entre le jeu et la vraie vie… « Ce temps-là est très important. Ça permet aussi de revenir sur les compétences développées : faire des recherches, travailler l’écriture et la lecture, se repérer dans l’espace et dans un univers en 3D, reproduire à l’échelle, apprendre à négocier, à collaborer, à débattre, à gérer des conflits, à imaginer de nouvelles solutions », énumère Jonathan Ponsard.
L’imagination au pouvoir
Cet écoquartier n’est qu’un des nombreux projets de sensibilisation à l’environnement développés avec Minecraft (version éducative) (3) par l’enseignant et ses élèves. Ils et elles ont aussi construit une maison écologique passive et calculé son coefficient énergétique, grâce à des fiches techniques de matériaux préparées par un papa architecte. Cette année, les élèves reproduisent leur école à l’échelle et imaginent comment l’adapter aux PMR.
Pour se rapprocher de la réalité, il existe même Minecraft à la carte (4), qui permet de reproduire automatiquement dans le jeu un quartier existant, à l’échelle, sur base de cartes IGN. Une autre option très utile, dans la version éducative du jeu vidéo, consiste à faire parler des personnages, comme dans une bande dessinée. Cela permet de lancer des défis au sein du jeu, d’amener des connaissances ou de renvoyer vers des infos complémentaires en ligne. L’enseignant·e et les élèves peuvent même s’appuyer sur des leçons ou des mondes virtuels clés-en-main, comme ceux créés par l’Unesco sous la thématique « climat et durabilité ».
« Je suis convaincu que l’éducation par la nature et l’éducation par le numérique sont complémentaires, affirme le technopédagogue. Par exemple, lorsqu’on fait l’école du dehors, en pleine nature, on demande aux enfants d’écrire de petits textes sur une feuille avec leurs observations, leurs émotions. De retour en classe, on corrige ces textes et on les fait vivre dans “le monde des écrits”, au sein de Minecraft. » Le jeu devient alors un lieu d’exposition virtuel, un carnet de route où les enfants vont illustrer et sauvegarder ce qu’ils et elles ont appris, pour ensuite le montrer aux autres classes et à leurs parents.
Le jeu déclenche de la motivation, du plaisir, il permet l’apprentissage par l’action et par l’essai-erreur. Néanmoins, l’enseignant rappelle qu’il n’est qu’un support à intégrer dans un dispositif éducatif, à compléter par des visites de terrain et d’autres activités. Julien Annart, co-auteur du manuel Educajeux (lire encadré ci-dessous), ne dit pas autre chose : « Le potentiel éducatif dépendra du dispositif imaginé par l’enseignant ou l’animateur, plus que du jeu en lui-même. En terme éducatif, avant la fascination du jeu, il faut d’abord penser à ce qu’on veut travailler et ce qui est efficace. »
(1) L'industrie du jeu vidéo rejetterait chaque année 37 millions de tonnes d'équivalent CO2, soit l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre de la Wallonie. L’avènement du jeu en streaming augmente cet impact. Infos et conseils sur le site de la RTBF, Greenly et Carbo academy
(2) www.edu-lab.be
(3) https://education.minecraft.net
(4) Service gratuit proposé par le portail de l’IGN: https://minecraft.ign.fr/
Pour lutter contre l’éco-anxiété
Jouer à certains jeux vidéo permettrait de réduire les manifestations d’éco-anxiété. C’est l’un des résultats préliminaires d’une recherche en cours à l’Université de Sherbrooke, menée auprès d’adultes vivant une détresse psychologique face aux changements climatiques et environnementaux. Les participant·es à l’étude ont testé 3 jeux : Terra Nil, où il s’agit de reconstruire les écosystèmes via le réensauvagement ; Utopia, dont l’objectif est de développer une ville par l’utilisation de ressources ; et Plant vs. Zombie, où des végétaux doivent repousser des attaques de zombies. « On a constaté une légère tendance des participants à avoir une vision plus positive de l’avenir et un sentiment de pouvoir agir après avoir joué à Terra Nil, mais également avec les deux autres jeux vidéo, dans une moindre mesure », résume Gabrielle Savoie, l’une des chercheuses. Les jeux redonneraient un sentiment de contrôle.
La nature des jeux vidéo
La nature est fortement représentée dans de nombreux jeux vidéo. Mais de quelle nature parlons-nous ? A quelques exceptions près, dans les jeux de stratégie et d’aventure, la nature est principalement utilitaire, vécue comme un obstacle à dominer ou une ressource à exploiter (généralement illi-mitée) (5). Chasser les animaux pour se développer, couper du bois pour construire une maison. Sans transfert spontané vers des apprentissages. « Personnellement, j’ai cultivé des milliers de tonnes de légumes dans des jeux, pour survivre ou pour nourrir des soldats ou des villes, mais ce n’est pas ça qui m’a appris à faire pousser une tomate, c’est ma voisine », constate Julien Annart, expert des pédagogies vidéoludiques.
Dans certains jeux d’aventure ou d’exploration (comme Abzû), l’environnement et la nature deviennent aussi le décor de nos flâneries, sources de contemplation. Les paysages y sont de plus en plus réalistes, grâce à une évolution graphique rendue possible par des processeurs dont la puissance est multipliée par deux tous les 18 mois. De quoi programmer leur remplacement rapide, et faire exploser la consommation de ressources et de données (et donc d’énergie).
Autre faiblesse : fruits de calculateurs et d’algorithmes, les jeux vidéo ont du mal à traiter des questions complexes d’écologie. La plupart reproduisent une vision simpliste, basée sur des automatismes et sur le modèle culturel dominant.
« Par exemple, dans le célèbre jeu SimCity, le joueur se retrouve aux commandes d’une ville, qu’il doit développer comme un urbaniste, illustre Julien Annart. Mais le type de cité produit avec SimCity est basé sur le modèle de la banlieue américaine, une vision des espaces allant vers le toujours plus, qui exclut la conflictualité des rapports sociaux. Ce qui serait intéressant pédagogiquement, ce serait de se questionner ensemble sur ces règles implicites. Au contraire des jeux de société, où l’apprentissage des règles fait partie du processus, les jeux vidéo ne sont pas transparents sur ce qu'ils proposent comme dispositifs. »
C.D.
(5) Lire l’analyse de Daniel Bonvoisin, publiée sur le site de Média Animation.